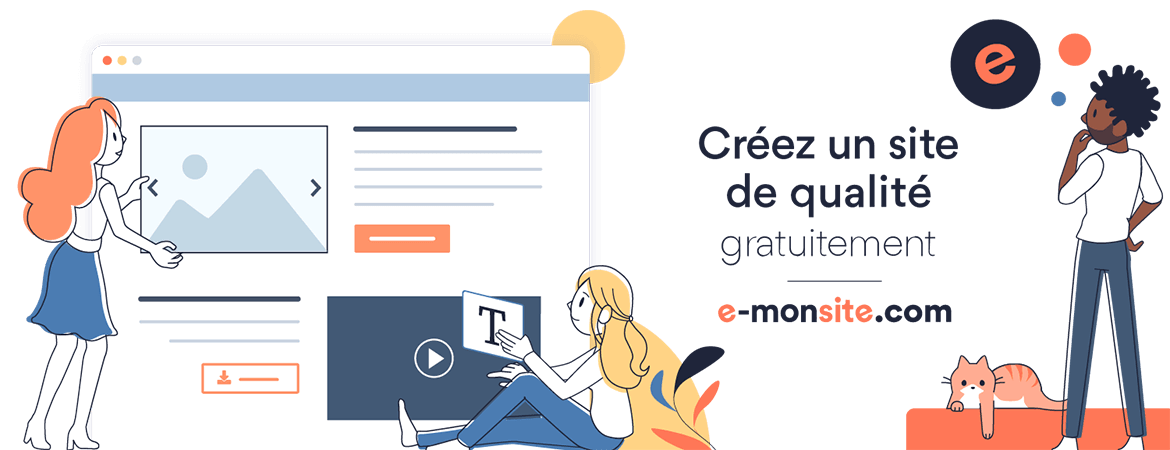- Accueil
- le débarquement à sidi Freidj, Ahmed Bencherif
le débarquement à sidi Freidj, Ahmed Bencherif
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Le débarquement
Le maréchal de Bourmont fut chargé du commandement du corps expéditionnaire, s’appuyant du plan d’attaque conçu par le capitaine Boutin en 1808. Aussitôt, la flotte s’était mise en mer, en navigation continue pendant plusieurs jours. Le débarquement eut lieu au port de sidi Freidj le 14 juin 1830. Le motif avancé de l’agression consistait à venger l’affront subi par le consul Duval frappé par le dey avec son éventail. À deux heures du matin, les troupes de la première division, à bord de leurs navires, attendaient sur le pont les chaloupes pour les mener en terre ferme. Chaque homme était muni de ses armes et munitions et il emportait en outre cinq jours de vivres. L’artillerie est chargée sur des chalands, puis poussée sur le rivage par des soldats. À cinq heures, le général Berthezene dirigea ses deux brigades vers la gorge de la presqu’ile. Des Arabes embusqués tirèrent des coups de feu puis ils disparurent. Les canons des Turcs, positionnés sur un mamelon, bombardaient ces troupes en marche. Une corvette et deux bricks avaient riposté et pilonné l’artillerie algérienne. La colonne en marche fut surprise par l’attaque de cinq-cents cavaliers arabes. Les artilleurs français les pilonnèrent à leur tour, faisant des victimes, non dénombrées. Alors cette cavalerie s’était repliée et disparut. Les brigades escaladèrent le mamelon obligèrent, au moyen de leur canonnade, les Turcs à battre en retraite, dans le désordre, abandonnant douze canons en fonte et deux mortiers en bronze, encore opérationnel et vite récupéré par la brigade.
Les combats
Le 15 du même mois, il fut procédé au déchargement du matériel de guerre, sans discontinuité : des voitures pour les batteries de campagne et d’autres équipements nécessaires pour détruire le château de l’Empereur. Quatre jours plus tard, au point du jour, des fantassins arabes ouvrirent le feu sur toute la ligne des avant-postes français. Derrière ces combattants, il y avait deux colonnes d’infanterie et de cavalerie : la colonne de gauche se composait de mille janissaires, six-mille Kabyles, vingt-mille hommes du contingent de Constantine et d’Oran, sous les ordres du bey de Constantine ; la colonne de droite était sous le commandement de l’agha Ibrahim, composée du contingent du Titteri, de Maures, de janissaires et de Coulouglis. Du côté français, deux divisions estimées à vingt-mille hommes, appuyées par l’artillerie, étaient en formation de combat. Sur la baie du côté est, les bricks pilonnaient les positions adverses avec leur artillerie. Les Algériens furent battus à Staoueli. Le 23 juin, les Algériens qui avaient attaqué à partir de Staoueli, devaient, pour libérer Alger, traverser plusieurs collines, distinctes, étagées, telle une fortification régulière, commandées par les hauteurs de Bouzareah. Le lendemain, les forces algériennes envahirent le plateau de Staouali. Elles furent repoussées par l’artillerie française. Désormais, la défaite de la Régence était actée et les forces françaises prirent possession de la ville. Battu et sans espoir de retourner la situation, le dey Hussein négocia son avenir et il capitula le 5 juillet à midi. Il déclara les portes ouvertes d’Alger.
Un combat très court dans le temps, d’une violence relative, selon les pertes humaines avancées par les uns et les autres, qui actait une défaite jamais imaginée par les janissaires ou leurs propres ennemis, un combat infaillible qui consacrait pour longtemps la domination d’un peuple trahi par ses gouvernants qui avaient tous les moyens pour continuer la lute. L’histoire est restée hélas muette sur cette victoire française trop rapide dont les artisans rendaient vaines toutes les tentatives de conciliation, tentée par l’amiral turc du sultan Mahmoud ou le pacha Mehemet Ali. La Guerre urbaine fortement envisagée par le haut commandement militaire et crainte par les autorités politiques n’eut finalement pas lieu. Les Arabes et les Kabyles regagnèrent tout simplement leurs plaines, leurs montagnes ou leurs villes, les poches vides et sans butin, déçus encore par le peu de gloire du dey Husseine.
Les janissaires avaient montré au peuple qu’ils étaient tout simplement une force d’occupation, coupé de tout lien avec la patrie. Ils avaient prouvé qu’ils étaient simplement des mercenaires qui amassaient leurs trésors dans la Casbah dont ils puisaient en cas de besoin urgent pour payer la solde des janissaires en mutinerie, comme il s’en produisait souvent.
Un combat s’achevait sans gloire avec la rapidité de l’éclair. Mais un autre commençait, plus âpre et plus long, plus violent et dramatique, authentique assumé par les fils de cette terre trop irriguée par le sang des martyrs depuis la nuit des temps.
Ajouter un commentaire