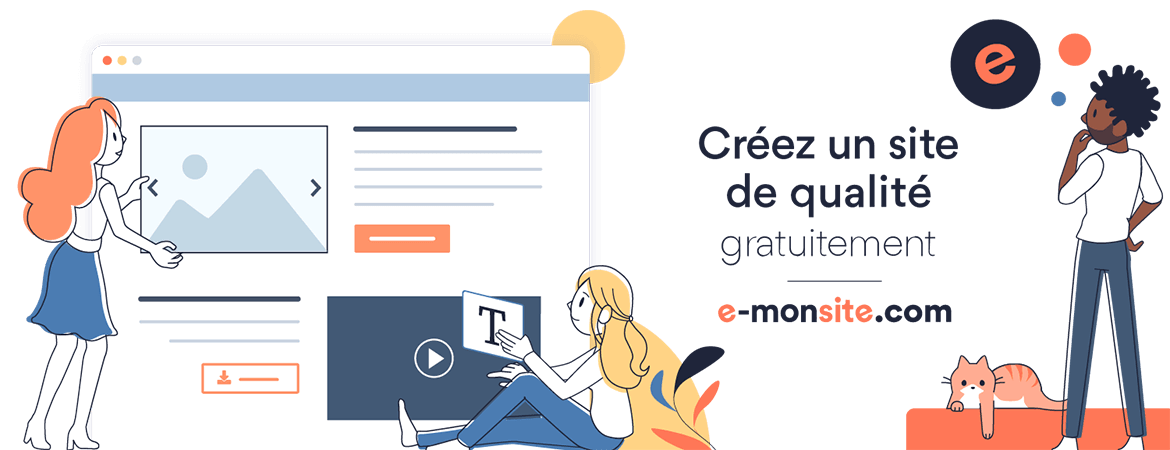- Accueil
- Youcef, cordonnier juif;Ahmed Bencherif
Youcef, cordonnier juif;Ahmed Bencherif
Gaston remit la paire de souliers au cordonnier avec un air de mépris, avant de dire avec arrogance : « Tiens sale juif, répare ma paire de souliers, à l’instant même ». Le vieillard en eut peur ; il la prospecta, en tremblant et répondit précipitamment que la réparation exigeait toute une journée de travail. Gaston piqua une de ses colères promptes et le traita de vermine et de menteur. Il hurlait toute sa fureur qui sortait par les pores de sa grosse chair, il était fou de rage, ne retenait pas sa mauvaise langue, déclarait tous les Juifs indésirables dans le pays, dans son pays, disait que les Européens n’auraient la paix de l’âme qu’au moment où ils les verront prendre chemin pour un pays quelconque. L’atmosphère était tendue. Hamza bouillonnait et faisait un grand effort pour maîtriser ses nerfs.
- Je vous assure, Mr Gaston, que cela va me demander toute une journée de travail, dit Youcef. Les semelles sont totalement à refaire et le cuir doit passer quelques heures au moule. Il faudra revenir demain. Soyez compréhensif, je vous en conjure.
Gaston savait que le cordonnier disait vrai. Il ne voulait pas toutefois se rendre à l’évidence, sa haine raciale occultant son bon sens. Il l’agrippa solidement par le cou et le secoua violemment. Il faillit étrangler sa victime très fragile qui sanglotait comme un petit enfant, toussotait comme un grand asthmatique, se débattait vainement pour se dégager de la forte étreinte. Gaston avait dépassé les bornes et jouissait du châtiment qu’il administrait au vieil homme. Hamza ne put en supporter de voir davantage. Il le tira par le bras, le bouscula et le propulsa dans la rue. Gaston essaya de revenir à la charge et le menaça. Hamza le retint solidement par la taille et lui dit : « Si tu ne le laisses pas tranquille, je te ferai manger le limon de la terre et ta putain de Graziella pourra en rire ». Hamza était désormais grand et fort, il ne craignait pas son ennemi, il pouvait en faire une chair à pâté. Gaston apprit vite la leçon : il perdit définitivement la bataille et partit à la hâte sans se retourner.
Le lendemain, vers le coup de dix heures, le vieux cordonnier ferma sa boutique et se rendit au tribunal pour porter plainte à l’encontre de Gaston. Il n’avait aucune ecchymose au cou, il souffrait plutôt d’une véritable psychose. Il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, imaginait des drames inqualifiables, prêtait l’ouïe au moindre bruit, demeurait cloîtré dans son lit, grelottait et transpirait tour à tour d’une fièvre spéciale, celle de la peur. Il vécut une épouvante. Samiha ne parvenait pas à le consoler, ni Sara dont il souffrait terriblement le malheur : elle était belle et jeune, mais personne n’osa venir demander sa main, ni les Européens, ni les Arabes. Il ne comprenait pas pourquoi le sort était si cruel à son égard et pourquoi encore ces gens ne désiraient pas s’unir par les liens sacrés du mariage avec les filles de sa communauté.
Il arriva au tribunal, sans trop d’illusions. Il comptait malgré tout sur sa vieillesse et sa pauvreté pour se faire entendre avec compassion. Le juge, Léon, l’avait débouté et congédié. Comme, il avait un témoin, il crut bon d’en faire appel, estimant qu’il pourrait détourner la difficulté à son avantage. C’était Hamza et il alla le retrouver dans le magasin. Hamza lui répondit que sa démarche était vouée à l’échec ; il l’accompagna tout de même. Le résultat n’avait pas changé et le vieillard dut s’avouer battu. Alors, il douta de cette citoyenneté que l’Etat français lui avait prodiguée et déplora amèrement cette discrimination entre les citoyens d’une même nation qui osait prétendre diffuser universellement la fraternité, l’égalité et l’équité.
Sur le chemin du retour, le vieillard marchait doucement, le cœur lourd de déceptions et assiégé de craintes. Sa vie paisible d’antan était désormais perdue par ce satané bulletin de vote qui était en fait une arme à double tranchant qu’il ne maniait pas personnellement et dont profitait le grand rabbin et l’une ou l’autre formation politique qui accédait au pouvoir, afin d’écraser au mieux les indigènes. Que faire ? Le grand rabbin disait qu’il connaissait au mieux les intérêts de sa communauté. En fait il vendait les voix au plus offrant. Youcef savait. Néanmoins, il suivait aveuglément les consignes du vote à chaque échéance et ne pouvait guère reconnaître que c’était là une réelle entourloupe. Il savait aussi d’expérience que le consortium ne lèverait pas le petit doigt pour aplanir ses gros ennuis. En la conjoncture, il regrettait sincèrement son ancien statut d’indigène, au moins il n’avait pas à entrer, malgré lui, dans ses tractations politiques dont il ne tirait aucun profit.
Hamza quitta le vieil homme, ne sachant où aller, ni quoi faire. Son esprit était ailleurs. Il pensait à Pauline. Elle lui manquait. Il devait la revoir. Mas où ? Il réfléchit un moment. Son cœur battait fort. Est-ce qu’il l’aimait ? Encore un moment d’introspection. Oui ! Il l’aimait. Il se sentit heureux de se confesser cet amour. Son visage prit de belles couleurs et ses yeux brillèrent. D’un pas hardi, le premier vers l’amour, il s’en alla voir Pauline chez elle. Il était gai. Il sifflait ou chantait. Il arriva à la maison, frappa à la porte et dit : « c’est moi Hamza ». Elle entendit la voix de son adoré, Hamza. Sa joie était immense. Elle ouvrit, l’enlaça, l’embrassa sur la joue. Elle sentit alors qu’elle l’aimait. « Entre, dit-elle »
- Pauline ! Tu m’as manqué. Tu es mon soleil. Au séminaire, je pensais à toi à chaque instant.
- Pauline ! Allons au jardin public. Nous serons bien mieux au milieu de la verdure et du chant des oiseaux.
Gaston remit la paire de souliers au cordonnier avec un air de mépris, avant de dire avec arrogance : « Tiens sale juif, répare ma paire de souliers, à l’instant même ». Le vieillard en eut peur ; il la prospecta, en tremblant et répondit précipitamment que la réparation exigeait toute une journée de travail. Gaston piqua une de ses colères promptes et le traita de vermine et de menteur. Il hurlait toute sa fureur qui sortait par les pores de sa grosse chair, il était fou de rage, ne retenait pas sa mauvaise langue, déclarait tous les Juifs indésirables dans le pays, dans son pays, disait que les Européens n’auraient la paix de l’âme qu’au moment où ils les verront prendre chemin pour un pays quelconque. L’atmosphère était tendue. Hamza bouillonnait et faisait un grand effort pour maîtriser ses nerfs.
- Je vous assure, Mr Gaston, que cela va me demander toute une journée de travail, dit Youcef. Les semelles sont totalement à refaire et le cuir doit passer quelques heures au moule. Il faudra revenir demain. Soyez compréhensif, je vous en conjure.
Gaston savait que le cordonnier disait vrai. Il ne voulait pas toutefois se rendre à l’évidence, sa haine raciale occultant son bon sens. Il l’agrippa solidement par le cou et le secoua violemment. Il faillit étrangler sa victime très fragile qui sanglotait comme un petit enfant, toussotait comme un grand asthmatique, se débattait vainement pour se dégager de la forte étreinte. Gaston avait dépassé les bornes et jouissait du châtiment qu’il administrait au vieil homme. Hamza ne put en supporter de voir davantage. Il le tira par le bras, le bouscula et le propulsa dans la rue. Gaston essaya de revenir à la charge et le menaça. Hamza le retint solidement par la taille et lui dit : « Si tu ne le laisses pas tranquille, je te ferai manger le limon de la terre et ta putain de Graziella pourra en rire ». Hamza était désormais grand et fort, il ne craignait pas son ennemi, il pouvait en faire une chair à pâté. Gaston apprit vite la leçon : il perdit définitivement la bataille et partit à la hâte sans se retourner.
Le lendemain, vers le coup de dix heures, le vieux cordonnier ferma sa boutique et se rendit au tribunal pour porter plainte à l’encontre de Gaston. Il n’avait aucune ecchymose au cou, il souffrait plutôt d’une véritable psychose. Il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, imaginait des drames inqualifiables, prêtait l’ouïe au moindre bruit, demeurait cloîtré dans son lit, grelottait et transpirait tour à tour d’une fièvre spéciale, celle de la peur. Il vécut une épouvante. Samiha ne parvenait pas à le consoler, ni Sara dont il souffrait terriblement le malheur : elle était belle et jeune, mais personne n’osa venir demander sa main, ni les Européens, ni les Arabes. Il ne comprenait pas pourquoi le sort était si cruel à son égard et pourquoi encore ces gens ne désiraient pas s’unir par les liens sacrés du mariage avec les filles de sa communauté.
Il arriva au tribunal, sans trop d’illusions. Il comptait malgré tout sur sa vieillesse et sa pauvreté pour se faire entendre avec compassion. Le juge, Léon, l’avait débouté et congédié. Comme, il avait un témoin, il crut bon d’en faire appel, estimant qu’il pourrait détourner la difficulté à son avantage. C’était Hamza et il alla le retrouver dans le magasin. Hamza lui répondit que sa démarche était vouée à l’échec ; il l’accompagna tout de même. Le résultat n’avait pas changé et le vieillard dut s’avouer battu. Alors, il douta de cette citoyenneté que l’Etat français lui avait prodiguée et déplora amèrement cette discrimination entre les citoyens d’une même nation qui osait prétendre diffuser universellement la fraternité, l’égalité et l’équité.
Sur le chemin du retour, le vieillard marchait doucement, le cœur lourd de déceptions et assiégé de craintes. Sa vie paisible d’antan était désormais perdue par ce satané bulletin de vote qui était en fait une arme à double tranchant qu’il ne maniait pas personnellement et dont profitait le grand rabbin et l’une ou l’autre formation politique qui accédait au pouvoir, afin d’écraser au mieux les indigènes. Que faire ? Le grand rabbin disait qu’il connaissait au mieux les intérêts de sa communauté. En fait il vendait les voix au plus offrant. Youcef savait. Néanmoins, il suivait aveuglément les consignes du vote à chaque échéance et ne pouvait guère reconnaître que c’était là une réelle entourloupe. Il savait aussi d’expérience que le consortium ne lèverait pas le petit doigt pour aplanir ses gros ennuis. En la conjoncture, il regrettait sincèrement son ancien statut d’indigène, au moins il n’avait pas à entrer, malgré lui, dans ses tractations politiques dont il ne tirait aucun profit.
Hamza quitta le vieil homme, ne sachant où aller, ni quoi faire. Son esprit était ailleurs. Il pensait à Pauline. Elle lui manquait. Il devait la revoir. Mas où ? Il réfléchit un moment. Son cœur battait fort. Est-ce qu’il l’aimait ? Encore un moment d’introspection. Oui ! Il l’aimait. Il se sentit heureux de se confesser cet amour. Son visage prit de belles couleurs et ses yeux brillèrent. D’un pas hardi, le premier vers l’amour, il s’en alla voir Pauline chez elle. Il était gai. Il sifflait ou chantait. Il arriva à la maison, frappa à la porte et dit : « c’est moi Hamza ». Elle entendit la voix de son adoré, Hamza. Sa joie était immense. Elle ouvrit, l’enlaça, l’embrassa sur la joue. Elle sentit alors qu’elle l’aimait. « Entre, dit-elle »
- Pauline ! Tu m’as manqué. Tu es mon soleil. Au séminaire, je pensais à toi à chaque instant.
- Pauline ! Allons au jardin public. Nous serons bien mieux au milieu de la verdure et du chant des oiseaux.
Gaston remit la paire de souliers au cordonnier avec un air de mépris, avant de dire avec arrogance : « Tiens sale juif, répare ma paire de souliers, à l’instant même ». Le vieillard en eut peur ; il la prospecta, en tremblant et répondit précipitamment que la réparation exigeait toute une journée de travail. Gaston piqua une de ses colères promptes et le traita de vermine et de menteur. Il hurlait toute sa fureur qui sortait par les pores de sa grosse chair, il était fou de rage, ne retenait pas sa mauvaise langue, déclarait tous les Juifs indésirables dans le pays, dans son pays, disait que les Européens n’auraient la paix de l’âme qu’au moment où ils les verront prendre chemin pour un pays quelconque. L’atmosphère était tendue. Hamza bouillonnait et faisait un grand effort pour maîtriser ses nerfs.
- Je vous assure, Mr Gaston, que cela va me demander toute une journée de travail, dit Youcef. Les semelles sont totalement à refaire et le cuir doit passer quelques heures au moule. Il faudra revenir demain. Soyez compréhensif, je vous en conjure.
Gaston savait que le cordonnier disait vrai. Il ne voulait pas toutefois se rendre à l’évidence, sa haine raciale occultant son bon sens. Il l’agrippa solidement par le cou et le secoua violemment. Il faillit étrangler sa victime très fragile qui sanglotait comme un petit enfant, toussotait comme un grand asthmatique, se débattait vainement pour se dégager de la forte étreinte. Gaston avait dépassé les bornes et jouissait du châtiment qu’il administrait au vieil homme. Hamza ne put en supporter de voir davantage. Il le tira par le bras, le bouscula et le propulsa dans la rue. Gaston essaya de revenir à la charge et le menaça. Hamza le retint solidement par la taille et lui dit : « Si tu ne le laisses pas tranquille, je te ferai manger le limon de la terre et ta putain de Graziella pourra en rire ». Hamza était désormais grand et fort, il ne craignait pas son ennemi, il pouvait en faire une chair à pâté. Gaston apprit vite la leçon : il perdit définitivement la bataille et partit à la hâte sans se retourner.
Le lendemain, vers le coup de dix heures, le vieux cordonnier ferma sa boutique et se rendit au tribunal pour porter plainte à l’encontre de Gaston. Il n’avait aucune ecchymose au cou, il souffrait plutôt d’une véritable psychose. Il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, imaginait des drames inqualifiables, prêtait l’ouïe au moindre bruit, demeurait cloîtré dans son lit, grelottait et transpirait tour à tour d’une fièvre spéciale, celle de la peur. Il vécut une épouvante. Samiha ne parvenait pas à le consoler, ni Sara dont il souffrait terriblement le malheur : elle était belle et jeune, mais personne n’osa venir demander sa main, ni les Européens, ni les Arabes. Il ne comprenait pas pourquoi le sort était si cruel à son égard et pourquoi encore ces gens ne désiraient pas s’unir par les liens sacrés du mariage avec les filles de sa communauté.
Il arriva au tribunal, sans trop d’illusions. Il comptait malgré tout sur sa vieillesse et sa pauvreté pour se faire entendre avec compassion. Le juge, Léon, l’avait débouté et congédié. Comme, il avait un témoin, il crut bon d’en faire appel, estimant qu’il pourrait détourner la difficulté à son avantage. C’était Hamza et il alla le retrouver dans le magasin. Hamza lui répondit que sa démarche était vouée à l’échec ; il l’accompagna tout de même. Le résultat n’avait pas changé et le vieillard dut s’avouer battu. Alors, il douta de cette citoyenneté que l’Etat français lui avait prodiguée et déplora amèrement cette discrimination entre les citoyens d’une même nation qui osait prétendre diffuser universellement la fraternité, l’égalité et l’équité.
Sur le chemin du retour, le vieillard marchait doucement, le cœur lourd de déceptions et assiégé de craintes. Sa vie paisible d’antan était désormais perdue par ce satané bulletin de vote qui était en fait une arme à double tranchant qu’il ne maniait pas personnellement et dont profitait le grand rabbin et l’une ou l’autre formation politique qui accédait au pouvoir, afin d’écraser au mieux les indigènes. Que faire ? Le grand rabbin disait qu’il connaissait au mieux les intérêts de sa communauté. En fait il vendait les voix au plus offrant. Youcef savait. Néanmoins, il suivait aveuglément les consignes du vote à chaque échéance et ne pouvait guère reconnaître que c’était là une réelle entourloupe. Il savait aussi d’expérience que le consortium ne lèverait pas le petit doigt pour aplanir ses gros ennuis. En la conjoncture, il regrettait sincèrement son ancien statut d’indigène, au moins il n’avait pas à entrer, malgré lui, dans ses tractations politiques dont il ne tirait aucun profit.
Hamza quitta le vieil homme, ne sachant où aller, ni quoi faire. Son esprit était ailleurs. Il pensait à Pauline. Elle lui manquait. Il devait la revoir. Mas où ? Il réfléchit un moment. Son cœur battait fort. Est-ce qu’il l’aimait ? Encore un moment d’introspection. Oui ! Il l’aimait. Il se sentit heureux de se confesser cet amour. Son visage prit de belles couleurs et ses yeux brillèrent. D’un pas hardi, le premier vers l’amour, il s’en alla voir Pauline chez elle. Il était gai. Il sifflait ou chantait. Il arriva à la maison, frappa à la porte et dit : « c’est moi Hamza ». Elle entendit la voix de son adoré, Hamza. Sa joie était immense. Elle ouvrit, l’enlaça, l’embrassa sur la joue. Elle sentit alors qu’elle l’aimait. « Entre, dit-elle »
- Pauline ! Tu m’as manqué. Tu es mon soleil. Au séminaire, je pensais à toi à chaque instant.
- Pauline ! Allons au jardin public. Nous serons bien mieux au milieu de la verdure et du chant des oiseaux.
Gaston remit la paire de souliers au cordonnier avec un air de mépris, avant de dire avec arrogance : « Tiens sale juif, répare ma paire de souliers, à l’instant même ». Le vieillard en eut peur ; il la prospecta, en tremblant et répondit précipitamment que la réparation exigeait toute une journée de travail. Gaston piqua une de ses colères promptes et le traita de vermine et de menteur. Il hurlait toute sa fureur qui sortait par les pores de sa grosse chair, il était fou de rage, ne retenait pas sa mauvaise langue, déclarait tous les Juifs indésirables dans le pays, dans son pays, disait que les Européens n’auraient la paix de l’âme qu’au moment où ils les verront prendre chemin pour un pays quelconque. L’atmosphère était tendue. Hamza bouillonnait et faisait un grand effort pour maîtriser ses nerfs.
- Je vous assure, Mr Gaston, que cela va me demander toute une journée de travail, dit Youcef. Les semelles sont totalement à refaire et le cuir doit passer quelques heures au moule. Il faudra revenir demain. Soyez compréhensif, je vous en conjure.
Gaston savait que le cordonnier disait vrai. Il ne voulait pas toutefois se rendre à l’évidence, sa haine raciale occultant son bon sens. Il l’agrippa solidement par le cou et le secoua violemment. Il faillit étrangler sa victime très fragile qui sanglotait comme un petit enfant, toussotait comme un grand asthmatique, se débattait vainement pour se dégager de la forte étreinte. Gaston avait dépassé les bornes et jouissait du châtiment qu’il administrait au vieil homme. Hamza ne put en supporter de voir davantage. Il le tira par le bras, le bouscula et le propulsa dans la rue. Gaston essaya de revenir à la charge et le menaça. Hamza le retint solidement par la taille et lui dit : « Si tu ne le laisses pas tranquille, je te ferai manger le limon de la terre et ta putain de Graziella pourra en rire ». Hamza était désormais grand et fort, il ne craignait pas son ennemi, il pouvait en faire une chair à pâté. Gaston apprit vite la leçon : il perdit définitivement la bataille et partit à la hâte sans se retourner.
Le lendemain, vers le coup de dix heures, le vieux cordonnier ferma sa boutique et se rendit au tribunal pour porter plainte à l’encontre de Gaston. Il n’avait aucune ecchymose au cou, il souffrait plutôt d’une véritable psychose. Il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, imaginait des drames inqualifiables, prêtait l’ouïe au moindre bruit, demeurait cloîtré dans son lit, grelottait et transpirait tour à tour d’une fièvre spéciale, celle de la peur. Il vécut une épouvante. Samiha ne parvenait pas à le consoler, ni Sara dont il souffrait terriblement le malheur : elle était belle et jeune, mais personne n’osa venir demander sa main, ni les Européens, ni les Arabes. Il ne comprenait pas pourquoi le sort était si cruel à son égard et pourquoi encore ces gens ne désiraient pas s’unir par les liens sacrés du mariage avec les filles de sa communauté.
Il arriva au tribunal, sans trop d’illusions. Il comptait malgré tout sur sa vieillesse et sa pauvreté pour se faire entendre avec compassion. Le juge, Léon, l’avait débouté et congédié. Comme, il avait un témoin, il crut bon d’en faire appel, estimant qu’il pourrait détourner la difficulté à son avantage. C’était Hamza et il alla le retrouver dans le magasin. Hamza lui répondit que sa démarche était vouée à l’échec ; il l’accompagna tout de même. Le résultat n’avait pas changé et le vieillard dut s’avouer battu. Alors, il douta de cette citoyenneté que l’Etat français lui avait prodiguée et déplora amèrement cette discrimination entre les citoyens d’une même nation qui osait prétendre diffuser universellement la fraternité, l’égalité et l’équité.
Sur le chemin du retour, le vieillard marchait doucement, le cœur lourd de déceptions et assiégé de craintes. Sa vie paisible d’antan était désormais perdue par ce satané bulletin de vote qui était en fait une arme à double tranchant qu’il ne maniait pas personnellement et dont profitait le grand rabbin et l’une ou l’autre formation politique qui accédait au pouvoir, afin d’écraser au mieux les indigènes. Que faire ? Le grand rabbin disait qu’il connaissait au mieux les intérêts de sa communauté. En fait il vendait les voix au plus offrant. Youcef savait. Néanmoins, il suivait aveuglément les consignes du vote à chaque échéance et ne pouvait guère reconnaître que c’était là une réelle entourloupe. Il savait aussi d’expérience que le consortium ne lèverait pas le petit doigt pour aplanir ses gros ennuis. En la conjoncture, il regrettait sincèrement son ancien statut d’indigène, au moins il n’avait pas à entrer, malgré lui, dans ses tractations politiques dont il ne tirait aucun profit.
Hamza quitta le vieil homme, ne sachant où aller, ni quoi faire. Son esprit était ailleurs. Il pensait à Pauline. Elle lui manquait. Il devait la revoir. Mas où ? Il réfléchit un moment. Son cœur battait fort. Est-ce qu’il l’aimait ? Encore un moment d’introspection. Oui ! Il l’aimait. Il se sentit heureux de se confesser cet amour. Son visage prit de belles couleurs et ses yeux brillèrent. D’un pas hardi, le premier vers l’amour, il s’en alla voir Pauline chez elle. Il était gai. Il sifflait ou chantait. Il arriva à la maison, frappa à la porte et dit : « c’est moi Hamza ». Elle entendit la voix de son adoré, Hamza. Sa joie était immense. Elle ouvrit, l’enlaça, l’embrassa sur la joue. Elle sentit alors qu’elle l’aimait. « Entre, dit-elle »
- Pauline ! Tu m’as manqué. Tu es mon soleil. Au séminaire, je pensais à toi à chaque instant.
- Pauline ! Allons au jardin public. Nous serons bien mieux au milieu de la verdure et du chant des oiseaux.
Gaston remit la paire de souliers au cordonnier avec un air de mépris, avant de dire avec arrogance : « Tiens sale juif, répare ma paire de souliers, à l’instant même ». Le vieillard en eut peur ; il la prospecta, en tremblant et répondit précipitamment que la réparation exigeait toute une journée de travail. Gaston piqua une de ses colères promptes et le traita de vermine et de menteur. Il hurlait toute sa fureur qui sortait par les pores de sa grosse chair, il était fou de rage, ne retenait pas sa mauvaise langue, déclarait tous les Juifs indésirables dans le pays, dans son pays, disait que les Européens n’auraient la paix de l’âme qu’au moment où ils les verront prendre chemin pour un pays quelconque. L’atmosphère était tendue. Hamza bouillonnait et faisait un grand effort pour maîtriser ses nerfs.
- Je vous assure, Mr Gaston, que cela va me demander toute une journée de travail, dit Youcef. Les semelles sont totalement à refaire et le cuir doit passer quelques heures au moule. Il faudra revenir demain. Soyez compréhensif, je vous en conjure.
Gaston savait que le cordonnier disait vrai. Il ne voulait pas toutefois se rendre à l’évidence, sa haine raciale occultant son bon sens. Il l’agrippa solidement par le cou et le secoua violemment. Il faillit étrangler sa victime très fragile qui sanglotait comme un petit enfant, toussotait comme un grand asthmatique, se débattait vainement pour se dégager de la forte étreinte. Gaston avait dépassé les bornes et jouissait du châtiment qu’il administrait au vieil homme. Hamza ne put en supporter de voir davantage. Il le tira par le bras, le bouscula et le propulsa dans la rue. Gaston essaya de revenir à la charge et le menaça. Hamza le retint solidement par la taille et lui dit : « Si tu ne le laisses pas tranquille, je te ferai manger le limon de la terre et ta putain de Graziella pourra en rire ». Hamza était désormais grand et fort, il ne craignait pas son ennemi, il pouvait en faire une chair à pâté. Gaston apprit vite la leçon : il perdit définitivement la bataille et partit à la hâte sans se retourner.
Le lendemain, vers le coup de dix heures, le vieux cordonnier ferma sa boutique et se rendit au tribunal pour porter plainte à l’encontre de Gaston. Il n’avait aucune ecchymose au cou, il souffrait plutôt d’une véritable psychose. Il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, imaginait des drames inqualifiables, prêtait l’ouïe au moindre bruit, demeurait cloîtré dans son lit, grelottait et transpirait tour à tour d’une fièvre spéciale, celle de la peur. Il vécut une épouvante. Samiha ne parvenait pas à le consoler, ni Sara dont il souffrait terriblement le malheur : elle était belle et jeune, mais personne n’osa venir demander sa main, ni les Européens, ni les Arabes. Il ne comprenait pas pourquoi le sort était si cruel à son égard et pourquoi encore ces gens ne désiraient pas s’unir par les liens sacrés du mariage avec les filles de sa communauté.
Il arriva au tribunal, sans trop d’illusions. Il comptait malgré tout sur sa vieillesse et sa pauvreté pour se faire entendre avec compassion. Le juge, Léon, l’avait débouté et congédié. Comme, il avait un témoin, il crut bon d’en faire appel, estimant qu’il pourrait détourner la difficulté à son avantage. C’était Hamza et il alla le retrouver dans le magasin. Hamza lui répondit que sa démarche était vouée à l’échec ; il l’accompagna tout de même. Le résultat n’avait pas changé et le vieillard dut s’avouer battu. Alors, il douta de cette citoyenneté que l’Etat français lui avait prodiguée et déplora amèrement cette discrimination entre les citoyens d’une même nation qui osait prétendre diffuser universellement la fraternité, l’égalité et l’équité.
Sur le chemin du retour, le vieillard marchait doucement, le cœur lourd de déceptions et assiégé de craintes. Sa vie paisible d’antan était désormais perdue par ce satané bulletin de vote qui était en fait une arme à double tranchant qu’il ne maniait pas personnellement et dont profitait le grand rabbin et l’une ou l’autre formation politique qui accédait au pouvoir, afin d’écraser au mieux les indigènes. Que faire ? Le grand rabbin disait qu’il connaissait au mieux les intérêts de sa communauté. En fait il vendait les voix au plus offrant. Youcef savait. Néanmoins, il suivait aveuglément les consignes du vote à chaque échéance et ne pouvait guère reconnaître que c’était là une réelle entourloupe. Il savait aussi d’expérience que le consortium ne lèverait pas le petit doigt pour aplanir ses gros ennuis. En la conjoncture, il regrettait sincèrement son ancien statut d’indigène, au moins il n’avait pas à entrer, malgré lui, dans ses tractations politiques dont il ne tirait aucun profit.
Hamza quitta le vieil homme, ne sachant où aller, ni quoi faire. Son esprit était ailleurs. Il pensait à Pauline. Elle lui manquait. Il devait la revoir. Mas où ? Il réfléchit un moment. Son cœur battait fort. Est-ce qu’il l’aimait ? Encore un moment d’introspection. Oui ! Il l’aimait. Il se sentit heureux de se confesser cet amour. Son visage prit de belles couleurs et ses yeux brillèrent. D’un pas hardi, le premier vers l’amour, il s’en alla voir Pauline chez elle. Il était gai. Il sifflait ou chantait. Il arriva à la maison, frappa à la porte et dit : « c’est moi Hamza ». Elle entendit la voix de son adoré, Hamza. Sa joie était immense. Elle ouvrit, l’enlaça, l’embrassa sur la joue. Elle sentit alors qu’elle l’aimait. « Entre, dit-elle »
- Pauline ! Tu m’as manqué. Tu es mon soleil. Au séminaire, je pensais à toi à chaque instant.
- Pauline ! Allons au jardin public. Nous serons bien mieux au milieu de la verdure et du chant des oiseaux.
Ajouter un commentaire