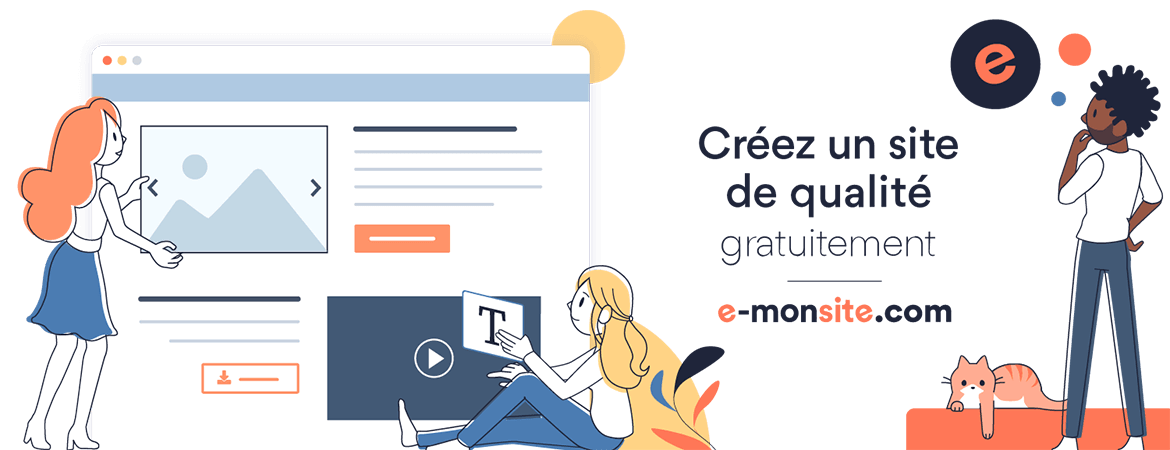- Accueil
- Colloque international école doctorale De traduction à l’université d’Oran 20/23 septembre 2014; ahmed bencherif
Colloque international école doctorale De traduction à l’université d’Oran 20/23 septembre 2014; ahmed bencherif
Colloque international école doctorale
De traduction à l’université d’Oran
20/23 septembre 2014
Axe d’intervention : traduction plurilinguisme
Titre de la communication : les limites de la traduction
Qui mènent au drame dans le roman
"Hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué"
Citation : comprendre les besoins, les possibilités et les limites des traductions permet de les utiliser de façon consciente, distanciée et adaptée. Philippe Blanchet, professeur de sociologie linguistique et didactique des langues à l’université de Rennes (France)
I. Plurilinguisme :
Tout ce qui n’est pas moi est différent de moi. Donc on est en présence de personnalités propres dont chacune revendique sa propre existence. Il y a diversité et cette diversité atteint la forme la plus naturelle à l’homme qui est la langue, celle-là même qui le différencie de l’animal. Alors nous sommes en présence de la diversité des langues et des cultures qui constitue une richesse humaine et un patrimoine universel à préserver de tous les dépérissements qui se manifestent éventuellement par manque d’enrichissement. Cette diversité est à protéger et promouvoir dans des mécanismes bien pensés. Il existe des milliers de langue et au sein d’une même langue, les nuances sont de taille à tel point que la traduction rencontre des obstacles ou se heurte à ses propres limites. Nous citons l’exemple de la langue arabe qui d’un espace géographique restreint et limité a dû parcourir une vaste sphère géographique s’adaptant aux dialectes locaux ; donc il y eut enrichissement réciproque. Ainsi la langue arabe maghrébine diffère de celle du golfe arabique ou du moyen Orient et à chacune il existe des spécificités propres. Les mots utilisés pour définir le même objet diffèrent ici ou là. Cependant la langue arabe dépasse nettement cet ensemble géographique et s’étend sur l’ensemble du monde musulman dans lequel elle est utilisée en religion principalement, c’est dire qu’elle côtoie les langues nationales de cette sphère géographique.
Mais cette diversité et cette pluralité linguistique et culturelle ont été combattues à outrance par les idéologies autoritaires ou normatives dans le but de faire prévaloir une langue uniforme. C’est le cas du Maghreb où la langue officielle, qui est l’arabe, côtoie les dialectes berbères dont seul le Tifinac, langue des Touaregs, est une langue écrite avec son alphabet et son dictionnaire. Ce phénomène remonte loin dans l’histoire et ne prend son expression ni pendant la découverte du Nouveau Monde, ni pendant les colonisations. En effet, cela remonte aux Grecs, du temps de Platon, puis d’Aristote. Car la langue grecque était une langue littéraire qui avait sa grammaire, donc développée pour permettre les échanges sociaux culturels entre individus et entre groupes, entre individus et l’état, entre l’état et les états, dont celui de la Perse antique. Les Grecs étaient voyageurs et avaient naturellement des contacts avec les populations des pays visités. Pour eux, il n’y avait qu’une seule langue tous les autres parlers étaient barbares, pour le seul fait qu’ils ne comprenaient pas cette langue. Cela était vrai pour les anciennes populations du mont des Ksour dont je suis fièrement le natif. Celles-ci étaient les Gétules qui étaient de redoutables guerriers qui faisaient toujours défections dans les rangs ennemis, qu’ils fussent Carthaginois ou Grecs ou encore Romains et plus tard Vandales. Les Grecs ne comprenaient pas leur langue qu’ils assimilaient à des cris. Pourtant, les Gétules avaient leur propre culture et descendaient des célèbres hommes des non moins célèbres Gravures Rupestres dont l’origine attestée est de 8.000 ans avant notre ère. D’ailleurs ces Gétules nous ont légué leur patrimoine matériel et immatériel. C’est ainsi que de nos jours, nous retrouvons des mots rescapés de leur langue, exemple : Tachatouft, C’est un nom de montagne. Ainsi, toutes les montagnes du Sud Ouest avaient leur propre nom que la mémoire collective n’a pas sauvegardé. Tout comme nous avons récupéré la légende qui avait mis fin au rite de la mort volontaire et groupée qu’ils pratiquaient, thème qui est l’objet de mon livre d’antiquité ‘Gétuliya et le voyage de la mort’. C’était un peuple foncièrement égoïste pour qui la mutualité n’existait pas. Personne n’aidait personne et quand une famille n’avait plus de vivres et de nourriture, au lieu de faire appel au groupe social, elle creusait sa propre sépulture et s’y mettait toute : hommes, femmes, garçons, filles, vieux et vielles.
Alors elle attendait la mort et de nos jours nous retrouvons ces tumulus disséminés dans notre région et dans la steppe jusqu’au nord du Sahara. Cette pratique disparut grâce à une fillette qui ne voulait pas mourir et se cacha chez son amie dont elle avait demandé l’aide, au moment où sa famille allait entreprendre ce voyage de la mort. Donc elle en réchappa à la mort et sauva son peuple après être comparue par devant un prétoire populaire. Dès cet instant cette pratique fut abolie après avoir été un sérieux handicap à l’accroissement démographique. Cette légende s’était produite 3 siècles avant notre ère et sa mémoire a pu arriver jusqu’à nous grâce à l’administrateur de la commune mixte, le capitaine Dessigny qui l’avait récupérée chez les indigènes ( Pardon le terme indigène est dans son contexte historique) en 1904 et avait procédé aux fouilles de quelques tumulus dont il avait trouvé un riche mobilier qui attestait de cette civilisation.
Cette diversité et cette pluralité culturelle sont plus perçues comme un facteur déstabilisant de la cohésion nationale. Si ces doutes sont en partie vrais dans la mesure où des politiques autonomistes voient le jour, l’état régulateur ne fait rien pour les éliminer d’un côté et de l’autre œuvrer à intégrer cette diversité et cette linguistique plurielle comme richesse, une plus-value. Nous constatons hélas que les états décolonisés ont suivi la stratégie des états coloniaux pour imposer une seule langue, un seul mode de pensée qui sont :
- La langue du colonisateur
- L’équation domination-soumission.
Pour dire un mot dans ce sens à propos de l’Algérie mon amour, nous dirons que la tâche ne fut jamais aisée. En débarquant le 14 juin 1830, les Français n’avaient pas trouvé une terre en jachère, un no mans land. Mais les conquérants français avaient trouvé une langue et une diversité culturelle, porteuses de civilisation dont elle ne cessa jamais de vouloir leur substituer sa propre langue et sa propre culture pendant 130 ans. Cette civilisation de l’Algérie avait pour ossature un appareil judiciaire efficace et puissant. Nous verrons plus loin comment il était resté debout, actif pleinement.
Cette diversité s’illustrait par une multitude de dialectes qui ne cessèrent jamais d’être utilisés dans les rapports sociaux avec l’autre, toujours avec des nuances fortes qui garantissaient à chacun d’eux une individualité propre. C’est dire que ces langues parlées étaient préservées par un fort communautarisme qui se manifeste par une démocratie non élective, en la figure d’une assemblée (djemaa) dont les membres représentaient une fraction du groupement humain citadin ou rural. Dans la région du mont des ksour par exemple, ces dialectes dépassent la dizaine et vivent en harmonie entre eux. En effet, la coexistence pacifique est sacrée et les différends sont réglés par la réunion extraordinaire des assemblées concernées, quand ce n’est pas un sage notable docte en sciences religieuses qui règle ce contentieux. Pour rendre hommage à ces notables, je souligne que mon défunt père appartenait à ces hommes d’exception, véritables régulateurs de la société dans lesquelles ils vivaient.
Cette pluralité de langues, plus de 13500, ( chiffre donné par le professeur P. Blanchet) constitue un patrimoine humain qu’il est difficile de négliger. Car elle s’est imposée depuis les âges les plus reculés. Cependant seuls quelques unes d’entre elles possèdent une certaine mobilité ou disons qu’elles ont vocation conquérante. C’est le cas de l’Arabe qui a conquis un grand espace géographique, du Portugal, de l’Espagnol, de l’Anglais, du Français dans une moindre mesure. Mais si l’Arabe était porteuse de message spirituel, les autres langues sus citées ont un autre objectif qui est matériel, soit la conquête de pays et la substitution de valeurs à d’autres valeurs qui sont les siennes.
Mais quelles sont les fonctions de la langue ? A l’intérieur du groupe, elle sert à relier, à échanger, à signifier. Elle est donc communicative et possède le pouvoir de créativité comme elle en conserve la mémoire collective grâce à ses mots qu’elle utilise, ses règles grammaticales. C’est dire qu’elle est le passé, le présent et l’avenir du groupe. En plus profond, c’est un moyen de revendication existentielle, la revendication de l’identité, ce qui est une légitimité en soi. Mais dès lors, qu’elle s’oriente vers l’autonomie, c’est chose complexe. Mais le pouvoir et ses relais ne doivent pas se précipiter pour condamner cette orientation. Au contraire, il doit avoir une grande capacité à convaincre plutôt que d’imposer son point de vue ou sa décision. En effet, le monde d’aujourd’hui est régi partagé entre de grands ensembles régionaux qui accèdent au pouvoir de négocier avec ses vis-à-vis. Pour citer l’exemple de l’Algérie, le mouvement autonomiste de la Kabylie n’est vraiment pas représentatif. En effet, il reste localisé dans cette région et de faible importance. Quant à l’état, il a fait une concession et je ne pense pas qu’il irait jusqu’à céder aux vœux autonomistes. Il a promu la langue Amazigh à une langue nationale et je ne crois pas qu’il puisse aller à son officialisation. Ce serait une grave erreur. D’abord, cette revendication est négligeable en nombre et dans l’espace. Les Amazigh du mont des ksour n’en veulent pas par exemple. D’ailleurs la majorité n’en veut pas. Cependant l’état n’en néglige pas la culture. La langue Amazigh est enseignée et possède ses supports médiatiques : télévision et radio. Je citerai maintenant l’exemple des Kurdes qui est très significatif et dont la population globale atteindrait 50 millions répartie entre 4 états : la Turquie, la Syrie, l’Irak, l’Iran. Ce peuple n’a pas demandé une autonomie fusion généralisée et approuvée par son ensemble ; il existe certes des mouvements autonomistes qui sont de faible impact. En effet, le Kurde d’Irak ne ressemble pas à celui de la Turquie, ni à celui de la Syrie, ni à celui de l’Iran. C’est dire que les Kurdes partagent les mêmes valeurs avec leur pays respectif.
II. Traduction entre langues différentes :
Puisqu’il existe autant de langues, la traduction devient inévitable pour la communication vers l’autre, cet humain parlant et bien sûr pensant. C’est la communication interculturelle à travers des expériences et des échanges verbaux avec leurs auteurs. Donc c’est une courroie de transmission de mœurs et de coutumes, de valeurs et d’enseignements qui seraient oubliés ou morts tout simplement sans cette traduction. C’est une sauveuse de l’humanité en quelque sorte et pour preuve la traduction des sciences et de la philosophie grecques par les Arabes en est la parfaite illustration, chose que les Romains n’avaient pas cru utile de réaliser.
L’activité plurilingue est composée souvent d’une activité de traduction, sinon l’universalisme auquel aspire chaque langue ne peut être pensé, schématisé, poursuivi. Cette traduction est en quelque sorte notre miroir dans un univers qui est déjà pluriel. C’est cette aspiration, somme toute légitime, qui permet à la langue de se faire connaitre par l’autre et lui enseigner sa culture. Qui peut entendre parler d’un parler dans l’Afrique tribale profonde, de son peuple, de sa culture, de ses mœurs et coutumes ? Personne. Mais pour qu’elle suscite l’intérêt de la traduction, il faut qu’elle soit elle-même porteuse de civilisation et de richesse socio-anthropologique. Or ce n’est pas le cas et on trouve ces peuplades qui vivent toujours sur le mode ancestral millénaire. Donc l’intérêt de la fonction de traduction est évident et incontournable, c’est la pierre angulaire de la coexistence universelle depuis toujours. Même en temps de guerre, elle est un impératif. Elle peut sauver un prisonnier de la mort, récolte des renseignements sans lesquels toute stratégie est inopérante.
Ceci dit, on se pose naturellement la question de savoir ce qu’est la traduction. Elle nous permet d’aborder un sens, une opinion, un discours, un mode de vie, des expressions linguistiques étrangères, puis de les assimiler et d’y répondre. Ceci nous mène à poser la question de savoir si elle possède la capacité de traduire tout d’une langue, autrement dit est-ce que chaque langue possède son particularisme, c'est-à-dire ses expressions propres qui sont intraduisibles. Tous les spécialistes s’accordent à donner ce particularisme à chaque langue, c’est en somme une personnalité propre qui la distingue d’une autre langue. En traduction, on atteint l’équivalent de l’énoncé de départ, mais presque jamais la fidélité. Mon expérience personnelle conforte ce constat par une expression clé de mon roman dont elle est le titre : Hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué. L’administrateur colonial avait échoué dans la traduction dont il n’avait pas cherché à obtenir ni l’équivalent ni la fidélité. On en parlera plus loin de cette lacune qui avait conduit au drame.
Pour éviter cette lacune ou contourner la difficulté, il y a lieu de connaitre l’énoncé et sa profondeur, ses précisions, ses nuances, lequel appartient à une autre culture qui possède ses propres variantes. Les professionnels de la traduction savent au départ qu’ils sont amenés à augmenter de volume le texte cible par rapport à l’énoncé de départ
Si dans la création littéraire ou autre, le choix lexical reflète la pensée du premier coup, il n’en est pas de même en traduction. Le traducteur choisit ses mots pour être le plus explicite, autrement dit il négocie dans un vocabulaire large ou restreint pour enfin arriver à l’équivalence. C’est dire que le traducteur compare entre deux langues, deux cultures et doit identifier les points communs traduisibles. C’est dire qu’il faut une maitrise des deux langues de départ et d’arrivée.
Or l’administrateur colonial dont j’ai cité l’exemple ne maitrisait pas la langue arabe, ce qui l’avait conduit à prendre une décision qui avait porté préjudice grave à son administré, auteur de cette expression aveu.
C’est ainsi qu’une œuvre traduite perd l’âme de l’original et bien prétentieux qui se targue d’être fidèle dans sa traduction. Il ne peut en assurer que l’équivalent. L’œuvre traduite est une nouvelle production. Nous avons tous lu des œuvres magistrales de très haut niveau mais leurs traducteurs étaient des génies. Que l’on ne s’étonne point si de nos jours la traduction s’est spécialisée en style littéraire, juridique, commercial. C’est une importante avancée dans le développement de cette science. Car entre le traducteur spécialisé et l’auteur de départ, il y a énormément de ressemblances et si peu de dissemblances. Ceci nous mène à soulever la question de traductibilité complète ou de traductibilité incomplète, qui reste toujours en débat par les scientifiques.
III. L’intraduisible :
La traduction forme une nouvelle production qui bouleverse le texte original, en ce sens qu’il en perd la fidélité, ou si vous voulez ce miroir qui nous permet vraiment de nous imprégner avec le texte de départ. C’est donc, il existe un phénomène d’intraduisibilité qui divise bien plus qu’il ne réalise un consensus des penseurs et des critiques. Dans la sphère de l’intraduisibilité, la poésie est intégrée. En effet, la poésie est surtout harmonie, musicalité, rime qu’il est bien difficile ou quasiment impossible à un traducteur de réussir, en ce sens même qu’elle forme un art. Il en est de même pour les Ecritures révélées qui sont sujettes à controverses et suscitent de multiples interprétations des savants des sciences religieuses. Pour ce qui est de la poésie, la traduction en français des dix grandes odes arabes est un échec total. Car elle ne répond pas aux exigences de cet art, tout comme elle s’éloigne assez loin du sens donné.
Pour ce qui est de la traduction du Coran, une tradition faisait durablement obstacle, en ce sens qu’il a été révélé en langue arabe et qu’il était inimitable. Comme la religion de l’islam a dû suivre la langue arabe conquérante pour prêcher le message universel, les besoins et les commodités de sa propagation avaient tôt ouvert une brèche à ces principes et ces traditions et avaient provoqué la traduction du Coran dans les langues locales, comme apar exemple le Turc ou le Persan. Le choc entre le monde musulman et chrétien était irréversible et la traduction du Coran fut exécutée assez tôt, au XII siècle par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, lequel fut exécuté par le clerc anglais Robert de Ketton, en Espagne, carrefour pensée entre Europe et Méditerranée. Puis au XVIII siècle les traductions produites sont plus exactes et moins apologétiques. Dès cette dernière époque, les clercs ne sont plus les traducteurs, mais des interprètes d’ambassades familiarisés avec les lettrés musulmans. Le XXème siècle ouvre de larges perspectives. L’entrée en lice de philologues orientalistes, ainsi des islamologues musulmans travaillent à une meilleure maitrise du Coran et des Commentaires prophète Mohammed. Cela n’a pas été possible bien entendu sans l’apprentissage de la langue arabe.
Cet effort de la traduction n’était pas l’exclusivité du Coran. La Bible en a connu aussi un travail immense dans ce sens, à différentes époques et sous diverses latitudes. Elle occupe le premier rang dans l’effort de traduction universalisant.
Le Nouveau Testament a été traduit en deux mille trois cents langues et la Bible complète en trois cents cinquante. Dans la langur française, il existe cent quarante versions complètes, depuis celle de Lefèbre d’Etaples en 1530.
Donc l’on constate que la langue arabe était déjà connue en France avant le débarquement des troupes française à sidi Frerrej. Effectivement, elle y était enseignée dans certains collèges, ainsi que l’hébreu. Elle y est d’abord enseignée dans un esprit humaniste au Collège royal, où Guillaume Postel est nommé en 1538 lecteur pour le grec, l’hébreu et l’arabe ; par la suite, la volonté de former des drogmans pour servir auprès des consuls dans le Levant est à l’origine de la fondation en 1669, sous l’impulsion de Colbert, de l’École des jeunes de langue, où l’arabe est enseigné parallèlement au turc, auquel s’ajoute ensuite le persan ; si elle survit à la Révolution, cette institution est éclipsée par l’École des langues orientales, créée en 1795 par la Convention1. Silvestre de Sacy, le premier titulaire de la chaire d’arabe de la nouvelle École, y dispense un enseignement livresque et théorique, mais à partir de 1803 son cours est complété par celui d’un grec-melkite rallié à Bonaparte, dom Raphaël de Monachis, chargé de donner des leçons d’arabe usuel et, en 1820, est fondée à l’École une chaire d’« arabe vulgaire » distincte de la première. Aussi, au début du xixe siècle, la connaissance des arabisants français porte-t-elle essentiellement sur l’arabe littéral – c’est-à-dire la langue écrite standard – et sur l’arabe usuel tel qu’il se pratique dans le Levant.
Comme je l’ai souligné précédemment, chaque langue possède son particularisme et recèle de mots et d’expressions quasiment intraduisibles ou mettent en échec tout effort de la traduction. Je citerai dans ce cas, une interjection dans le titre de mon roman psychosociologique qui repose sur une histoire vraie en Algérie coloniale, plus précisément à Ain-Sefra, ex capitale du Sud Oranais, rendue célèbre par le résistant irréductible cheikh Bouamama qui ne remit jamais l’épée dans le fourreau pendant vingt cinq ans, soit jusqu’à sa mort en 1908, rendue aussi non moins célèbre par l’écrivaine et aventurière Isabelle Eberhardt dont les restes sacrés reposent au cimetière musulman de cette ville, depuis le 21 octobre 1904. Et bien entendu, cette ville offre un intérêt scientifique évident incarné par le patrimoine matériel qu’il s’agisse des gravures rupestres qui datent de près de 10.000 ans ou qu’il s’agisse des tumulus disséminés dans toute la région, principalement au pied de la montagne de Mekhter sur le versant qui domine la vallée de cette ville et dont la mutualité s’instaura trois siècles avant notre ère.
Le deuxième volet de mon étude porte sur le titre de mon roman : hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué ! Pour être plus précis, elle en analyse l’interjection : hé ! Hé ! Hé ! Il convient de définir l’interjection qui est propre à chaque langue. Elle est principalement un ton qui signifie une affectivité, une passion. Elle peut s’employer à une douleur ressentie, une joie exprimée, une admiration, une crainte, un mépris, l’ironie, l’amour. Dans son oralité, elle est surtout une sonorité. Donc, elle traduit les émotions de l’âme. Dans l’écriture, elle est suivie d’un point d’exclamation. Soulignons au passage que le point d’exclamation était désigné auparavant par point d’interjection. Je cite un exemple pour en illustrer le sens, extrait du livre de Charles Bally ‘ le Langage et la vie (1952) ‘ la scène se passe chez le dentiste : « …tout d’un coup j’ai senti l’outil sur ma dent : alors ououou ! puis crac ! La première interjection est un réflexe dû à la douleur, la seconde rend compte d’un bruit.
Pour revenir à l’expression entière, titre du roman, il convient tout d’abord d’en donner le contexte dans lequel elle avait été produite, qui lui en assuré à son tour une dimension de légende. Mohamed, le héros du roman, va se culpabiliser chez l’administrateur colonial, qui était en même temps chef de la commune mixte, d’un meurtre qu’il n’avait pas commis sur la personne d’un légionnaire, tyranneau du village, à force herculéenne. Le contexte social était marqué par un activisme de militantisme libérateur indépendantiste, donc la chose prit une dimension nationaliste, en ce sens que ce meurtre prit une connotation d’assassinat politique. Ce meurtre fut l’évènement dans le village et tous en parlaient avec admiration, car tous attendaient la levée des armes pour libérer le pays. Le meurtrier passa dans la population indigène comme un héros et aux yeux des Européens comme un justicier. Car tous souffraient la tyrannie du légionnaire sur tout recours à la loi échouait pour empêcher ses exactions ou verbales ou physiques, principalement dans les bars au cours de ses cuites. Mohamed, le héros du roman, qui avait déjà la réputation de vaniteux, était jaloux du meurtrier, puis il se mit à endosser peu à peu l’acte, l’assume et va s’accuser à tort du meurtre chez l’administrateur avec qui il avait communiqué en arabe. L’administrateur, quant à lui, comprit ce que Mohamed disait.
L’administrateur avait compris, car il parlait et écrivait l’arabe. La langue arabe était une épreuve obligatoire au concours de recrutement et éliminatoire. Bien entendu, le niveau était élémentaire, mais il permettait à ce corps de fonctionnaires de pouvoir échanger directement avec les indigènes, pour les besoins de la cause coloniale et de manière générale de gestion administrative et sécuritaire. En effet, l’administrateur était de droit président de la commission de discipline, genre de tribunal expéditif, sans droit de défense, ni recours. Il sanctionnait des délits par des emprisonnements jusqu’à trois mois. Les sanctions plus grandes étaient du ressort des trois préfets de la colonie et du gouverneur général. C’est ce que l’on appelait l’internement administratif. Signalons que le gouverneur général emprisonnait les indigènes coupables jusqu’à une année de prison et pouvait décider de la déportation pour atteinte à la sûreté de l’état.
Mais pourquoi la France, qui était censée être un pays de Droit, recourait à l’administrateur au lieu du juge. La principale raison résulte de l’existence d’un système judicaire fort, efficace, expéditif à moindre frais dont elle avait hérité. Dès les premières années de la conquête, la France s’était engagée à respecter les lois et les coutumes, le droit personnel en matière de divorce, de succession, enfin de manière générale la jurisprudence musulmane pour mettre fin aux hostilités et se prémunir des révoltes, lesquelles durèrent quand même quarante années. Elle y trouva également une langue, une culture qu’il lui était impossible de les remplacer par les siennes. Le cadi état compétent pour les crimes, les contentieux entre indigènes eux-mêmes et entre indigènes et Européens. Donc cette justice assura au pays une importante partie de la souveraineté nationale pendant longtemps, en dépit oppositions vigoureuse des colons. Ce n’est que vers 1890, que ses attributions commencèrent à connaitre leur déclin. Donc la France n’avait pas trouvé un pays vierge et des populations primitives comme il pouvait en exister en Afrique profonde, c'est-à-dire les pays qui ne furent pas touché par l’islamisation. Parallèlement à ce corps d’administrateur, elle avait créé des juges de pais qui avaient pratiquement les mêmes compétences que l’administrateur. C’était une juridiction hybride qui n’obéissait pas au droit, qui rendait aussi ses décisions en dehors des lois et règlements en vigueur sur le sol français.
Revenons à cette expression du roman ‘hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué’ et essayons d’en distinguer les nuances d’une part et d’autre part comment l’administrateur l’avait comprise. Le mot originel est : yahe ! yahe ! yahe ! Au cours des âges de la langue arabe, cette interjection avait reçu de notables modifications et altérations. Son origine vient de la péninsule arabique et faisait partie du lexique arabe. Elle était employée par le chamelier pour appeler en certain cri ses chameaux et ceux-ci obéissaient. Elle fut modifiée encore et trouva carrément sa place dans le langage d’échange humain. Elle fut utilisée par un individu pour dire à un autre individu de venir. Là elle fut un carrément verbe. Puis son sens originel fut carrément perdu. Sa phonie demeura et elle fut comprise en deux sens : l’un interjectif, l’autre interrogatif. Sa double signification se traduit par quoi. Donc si on traduit on accède à l’expression suivante : quoi ? Quoi ? Quoi ? C’est moi qui l’ai tué. On constate que la phrase est inintelligible et on se demande comment l’administrateur avait assimilé. Ce chef de la commune mixte avait compris sur le ton employé par Mohamed qui prétendait être coupable d’une part et d’autre part il avait mal interprété l’interjection par hé ! Hé ! Hé !, ce qui est une forme de dérision tout en revendiquant l’acte.
Cet intelligible est appelé opacité par Christine Durieux. C'est-à-dire que l’élément intraduisible est opaque et comme on doit traduire, les solutions envisageables s’éloignent progressivement de la fonction d’équivalence recherchée. Puis on a tendance à invoquer la banalisation, la facilité à clore ce chapitre. Donc pour traduire, on cherche un compromis, une négociation dans le lexique proposé. Car il en existe des variantes et il faut choisir la meilleure illustration, la meilleure interprétation. Déjà que dans toute langue, il existe des mots qui ont plusieurs significations divergentes. Alors il faut bien négocier et je crois que le terme utilisé par Christine Durieux est justement valable. Car il rend compte de cet exercice intellectuel pour produire cette traduction de l’intraduisible. Cette traductrice nous dit que le meilleur compromis à retenir est fonction du vouloir dire, de la situation de la communication.
Situation de la communication ? Voilà bien une dimension que l’administrateur avait totalement méconnue, ce qui constituait une faute grave. Car il était en présence d’une situation grave : un meurtre et un homme qui se porta coupable volontairement, sans qu’il y fût poussé par une tierce personne. Donc l’administrateur devait chercher à connaitre la psychologie du personnage, qui était très connu dans le village. S’il avait demandé des informations sur son caractère, il aurait su que le personnage était un vaniteux notoirement connu dans le bled, aussi bien par les indigènes que les Européens. Dans ce cas de figure, il aurait bien sa décision adéquate qui était de renvoyer le personnage chez lui et de laisser se poursuivre l’enquête de gendarmerie qui buttait déjà. Plût que cette enquête butât que d’envoyer un innocent au tribunal militaire qui le condamna à cinq ans de prison dont il purgea une année dans les conditions les plus lamentables dans un pénitencier dans le Grand Sud. Il fut libéré donc mais il resta convaincu qu’il était coupable et que la justice n’avait pas suivi son cours naturel. (Enfin, vous trouverez en annexe, une synthèse du roman dont il est question).
Bibliographie.
- La critique Littéraire au XXe Siècle,
Jean –Yves Tadié. POCKET, 1997
- Linguistiques et colonialisme,
Louis-Jean Calvet. Petite Bibliothèque Payat 1988.
.
- Convergences Critiques ,
Christiane Achour , Simone Rezzoug ,OPU2009
- Signes,Langues et Congnition.
Pierre Yves Raccach. , L’Harmattan 2005
- Sémantique interprétative,
François Rastier ,PUF,2009
- Langue et pouvoir en Algérie ;
SEGUIER ,1999
- Deux conceptions de l’action judiciaire aux colonies. Magistrats et administrateurs en Afrique occidentale française (1887-1912)
Laurent MANIÈRE (Inalco/Paris 7-SEDET)
- Quelques données et réflexions sur la traduction des interjections
Bertrand Richet, Université Charles-de-Gaulle — Lille 3
- Plurilinguisme et Traduction Enjeux, possibilités, limites
Cours de Philippe Blanchet.
- L’acte de traduction commentaire sur l’âge de la traduction de Antoine Berman
Mathieu Dosse
- Traduire l’intraduisible
Gabriel Le Bras , Henri Desroche, Jacques Maitre,
- Traduire l’intraduisible : négocier un compromis
Christine Durieux
Biographie
Ahmed Bencherif est né le 4 mai 1946 à Ain-Sefra. Il y fit ses études primaires, puis secondaires au Lycée Lavigerie des Pères Blancs, puis il poursuivit des études de droit public à Bechar. Ses vocations littéraires étaient certaines, il fit des essais de 2 romans et un recueil de poésie, non publiés cependant dans les années soixante dix, tombés hélas en déperdition par suites de circonstances exceptionnelles. Instituteur, puis administrateur. En 1883, il élabora une courte biographie du résistant Bouamama, 1881-1908, à la demande du ministère de la Culture. . Il est aussi amené à connaître deux figues emblématiques qui avaient marqué Ain-Sefra : le maréchal Lyautey et Isabelle Eberhardt.
La loi française sur l’apologie du colonialisme le requit d’enquêter sur l’histoire coloniale et d’élaborer de façon exhaustive et objective l’œuvre Marguerite qui mettait à la disposition du lectorat d’abord français puis algérien le drame colonial et la praxis de domination. Ce travail avait nécessitait de longues recherches et fut couronné par sa publication en France en deux tomes. C’est là que commença son parcours littéraire.
A- Ouvrages publiés :
- Marguerite tome 1 roman historique
Juin 2008 Editions Publibook Paris
- La grande ode livre poésie
Décembre 2008 Editions Publibook Paris
- Marguerite tome 2 roman historique
Octobre 2009 Editions Edilivre Paris
- Odyssée livre poésie thèmes universels
Avril 2010 Editions Edilivre Paris
- Hé hé hé c’est moi qui l’ai tué roman psychologie sociale-
Mars 2013 Editions Dar Rouh Constantine
B - Ouvrages sous presse :
- Gétuliya et le voyage de la mort
- L’aube d’une révolution 26 avril 1901
" Margueritte Algérie
Approche communicationnelle"
C- Ouvrage à paraître :
Les odes de l’Amour
Activités culturelles :
ü Présentation vente dédicace ouvrage Marguerite la grande ode Au salon international du livre Paris mars 2009 ; non conclue Pour refus de visa par les services consulaires
ü présentation vente dédicace juin 2009 Maison de la culture Naama
ü communication à l’université d’Oran école doctorale traductologie : Œuvre Marguerite la poésie populaire et les perspectives de traduction décembre 2010
ü communication sur le 14 juillet 1953 sanglant à Paris et le martyr Daoui Larbi, militant MTLD d’Ain-Sefra ;répression de la manifestation pacifique à Paris qui revendiquait l’indépendance 5 juillet 2011
ü Communication sur la vie et l’œuvre du poète et moudjahed Chami Ahmed 13 janvier 2012 maison de la culture Mila .
ü récital poétique au musée du Moudjahed de Naama 31 octobre 2012
ü présentation vente dédicace ouvrage hé hé hé c’est moi qui l’ai tué Centre culturel Frantz Fanon Mecheria.
ü Invité plusieurs fois de radio Naama
ü Invité de canal Algérie à l’émission Trésors d’Algérie, Expression Livres, A cœur ouvert, Planète Sahara sur Isabelle Eberhardt
ü Interview avec la télévision algérienne nationale sur mon ouvrage hé hé hé c’est moi qui l’ai tué vente dédicace au palais de la culture de Bechar, grande ville saharienne. En attente de programmation
Ahmed Bencherif
Ecrivain et poète
Poète membre de la société des poètes français
Président section Naama de l’union des écrivains algériens
Boite postale 9 Naama
Tel +2130665842352
Email : haida.bencherif@yahoo.fr
Site : http://bencherif.unblog.fr
ANNEXE
Présentation analytique
de l’ouvrage
Hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué
Vente dédicace
Au centre culturel de Frantz Fanon
Méchéria Samedi 20 avril 2013
Dans sa note de lecture, un internaute a vu deux modes d’écriture différenciables entre mon premier roman (Marguerite) et le second (Hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué). Effectivement, il y a une mutation entre le roman historique qu’est Marguerite et le roman de psychologie sociale qu’est le texte Hé hé hé c’est moi qui l’ai tué. Dans le premier, le personnage principal était un adolescent qui rêvait de gloire et de grandeur et qu’il fallait élever dans la trame narrative en respectant les actes et les paroles compatibles avec tout autre adolescent dans le monde. Dans le second, le personnage principal est un adulte qui a son comportement et sa personnalité propres. Un autre internaute a vu dans le second roman la ressuscitation de la mémoire collective de la ville natale de l’auteur, conscient du fait que celui-ci n’avait été ni témoin, ni acteur. Dans l’analyse de ces deux lecteurs, il existe une part de vérité.
Nous avons dit que le roman est classifié dans la psychologie sociale, c'est-à-dire qu’il procède tour à tour de psychologie et de sociologie. Ce mode d’écriture a été imposé par le sujet qui visait à ressusciter le quotidien d’une petite ville cosmopolite par ses diverses ethnies, ses confessions et le mode de vie de chacune d’elles, avec les inégalités sociales qui prévalaient. Donc c’est ici l’aspect sociologique Il a été également déterminé par le type de personnages qui évoluaient dans la trame narrative, selon leurs caractères, leurs motivations, leurs désirs, leurs frustrations. L’étude psychologique de ces personnages n’était pas aisée. Il fallait donc respecter la personnalité de chacun en fonction de ces critères énoncés. Ces personnages étaient des gens ordinaires qui appartenaient à la dernière hiérarchie sociale, qui ne possédaient ni charisme, ni force persuasive, afin de s’aventurer à la conquête d’un certain leadership. Malgré ces désavantages dont ils souffraient, il n’en demeure pas moins qu’ils incarnaient une symbolique et les gens recherchaient leur compagnie. Ils n’avaient rien à offrir, sauf leur verbe, leur humour, leurs facultés psychologiques atypiques. Chacun d’eux incarnaient un livre dont la lecture ne s’achevait jamais, tant le renouveau état chez eux assuré par leur propre génie.
Qui étaient ces personnages ? Ils étaient le maraudeur, le mythomane, le vaniteux, l’idiot, le pied-bot, le frappeur de l’œil, la libertine, c'est-à-dire les personnages d’un livre qui s’intéresse à l’étude psychologique de la littérature française classique du 19ème siècle. C’est dans cette pléiade qu’évoluait le personnage principal qui n’était autre que le vaniteux. Celui-ci avait son vis-à-vis en la personne du mythomane. La proximité entre les deux personnages était malgré tout accommodante. Elle s’imposait dans toutes les assemblées de loisirs que tenaient au quotidien tous ces personnages. Elle ne générait aucun ressentiment entre eux, ni jalousie, ni envie. Chacun se suffisait de lui-même et s’inquiétait de son propre aura sur ses spectateurs de bouffonnerie en plein air. Le vaniteux agit ; le mythomane délire dans son imaginaire et ses fabulations sont bien construites qu’il est difficile de les déceler.
Le contexte social avait pour espace dans la petite ville coloniale présaharienne, Ain-Sefra, dans laquelle écumait le nationalisme, après le long silence des armes qui avait suivi la longue insurrection de Bouamama. Des ethnies et des confessions cohabitaient dans leur quotidien dans leur quête permanente du pain, dans leur modestie, leur humeur, leurs désirs, leurs ambitions, loin cependant des frictions politiques qui engendrent irrémédiablement des antagonismes. Tout le monde connaissait tout le monde et personne ne possédait une fortune outrageante qui infailliblement aurait indisposé l’état d’esprit collectif et créé des animosités individuelles. Il n’existait pas de grands bourgeois dans cette petite ville et les petits bourgeois se comptaient sur le bout des doigts. Certes il existait des inégalités sociales, mais elles n’étaient pas criardes, loin d’être offensantes. L’on retient aussi que personne ne mourrait de faim, car chacun se débrouillait comme il pouvait pour gagner sa subsistance.
L’élément sociologique qui retient l’observateur se situe au niveau de la tolérance entre les individus, entre les religieux, entre ceux-ci et ceux-là. Il n’existait donc aucune secte religieuse chrétienne, ni mouvement salafiste musulman, encore moins des extrémistes juifs dont la communauté était négligeable en nombre. Les lieux du culte étaient ouverts pour leurs propres fidèles dont les prêtres, rabbin et imams officiaient leur ministère loin de tout prosélytisme. Les bars avaient aussi leurs fidèles de diverses ethnies et diverses confessions : Musulman, chrétien, juif faisaient la bringue à un même comptoir. La mosquée, l’école coranique, les taleb et les oulémas existaient aussi. Mais ils ne s’insurgeaient pas contre les buveurs de vin, les amateurs du vice, les quelques libertines appartenant à leur propre religion. Pourtant, l’islam orthodoxe malékite prédominait comme à son apparition au 8ème siècle de notre ère au grand Maghreb. Il faut dire aussi que la petite ville vivait dans un conservatisme collectif et que toute innovation pouvait offusquer le musulman, le chrétien ou le juif. Nous n’omettrons pas de dire ce même caractère tolérant régissait les écoles ecclésiastiques dont la plus importante, le lycée Institution Lavigerie, ou celle de sœurs blanches qui prodiguaient l’enseignement général ou artisanal.
Cette tolérance au niveau individuel s’illustrait dans la relation de la cité chérifienne avec son fils, le maraudeur, qui ne fut jamais inquiété, ni maltraité, ni matraqué pour ses maraudages de fruits et légumes, pour l’unique raison qu’il était handicapé physiquement et chef de famille nombreuse. C’est un exemple comme tant d’autres non cités qui illustraient la mutualité de la société colonisée face à ses moyes de subsistance très durs et quasiment incertains : les citadins gagnaient leur vie dans une agriculture vivrière ou dans quelques emplois de commis dans des administrations ou comme saisonniers dans des chantiers fortuits ; les autres, qui nomadisaient, tiraient leur subsistance de l’élevage.
La trame narrative évoluait autour du vaniteux, le dénommé Mohamed dont la personnalité psychologique force notre admiration dans sa simplicité, sa modestie, son air affable. Mais il n’était guère bouffon. Au contraire, il ordonnait bien sa vie, son jardin, ses heures de loisirs. Ce caractère vaniteux n’est pas spécial, exceptionnel à son propre psychique. Il est universel et a suscité l’intérêt des écrivains, des psychologues, des penseurs qui en étaient tantôt émerveillés, tantôt critiques négativement. Les citations anciennes ou contemporaines sur cette faculté mentale ont foisonné. Pour donner une définition plus ou moins rapprochée, la référence à la citation de l’écrivain belge Jean Mergeai : « L’orgueilleux se regarde dans un miroir, le vaniteux se contemple dans les yeux des autres ». On déduit qu’il existe un lien entre l’orgueil et la vanité. Celle-ci par conséquent végète en nous-même à divers degrés. L’écrivain français Alphonse Karr étaye ce postulat en disant : « La vanité est l’écume de l’orgueil ». Ainsi Friedrich Nietzsche conforte cette idée par sa citation : « La vanité d’autrui n’offense notre goût que lorsqu’elle choque notre propre vanité ». Marc Aurèle définit le vaniteux dans sa relation avec les autres : « Le vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l’activité d’autrui ; le voluptueux de ses propres sensations et l’homme intelligent de ses propres actions ».
Le vaniteux cherche à se vanter sans justification aucune, il peut même mentir par pure prétention et il en est conscient, contrairement au mythomane dont les mensonges ne sont pas intentionnels. Il cherchera toujours à être encensé par une quelconque formulation sensée ou maladroite. Quant à l’orgueilleux, il méprise les éloges indélicats
Tous ces traits caractériels se retrouvent inclus dans la personnalité de Mohamed, le personnage central. Sa femme, Fatma, les connaît merveilleusement bien et sait les courtiser pour obtenir ce qu’elle désire, assouvir ses caprices. Elle ne manipule pas son mari, mais elle le gonfle et la mue caractérielle s’opère vite. Mohamed passe alors de l’état colérique à l’état bon enfant. Il lui achète les choses qui font plaisir à toute femme : foulard, petit flacon de parfum, produits de maquillage artisanaux, robes d’intérieur à bas prix. Il lui donne également l’argent pour aller au bain, remplir son devoir sociétal de congratulation aux naissances, baptêmes, mariage. Pourtant leur foyer vivait littéralement dans la précarité. Fatma l’appelle : « mon lion ». C’est parti : Mohamed rugit et s’apprête à aller en chasse pour rapporter la proie à sa compagne Fatma parvient à convaincre son mari pour lui acheter une nouvelle robe de valeur (QIMA), à l’occasion du mariage de son propre frère, malgré la précarité de leur subsistance. Mohamed fait alors la tournée des magasins de tissus pour l’acheter à crédit, sachant que le remboursement état vraiment aléatoire, ce que les marchands n’ignoraient pas et le renvoyaient sans façon. Là encore l’orgueil le sauva chez le dernier marchand qui l’offensa en présence du caïd, un parent de sa femme. Le caïd paya la robe et Mohamed repartit très heureux, comme peut l’être un enfant.
Le destin de Mohamed ne s’arrêta pas là. Son orgueil écuma et commença pour lui une longue histoire au bar. Il picolait presque tous les jours avec son ami Brahim qui en courtisait également la vanité de façon magistrale pour économiser ses sous. Au bar tout le monde venait des civils, des militaires, des brutes, des sages, des couples français, la libertine. Parmi ces buveurs invétérés, il y avait un tyranneau, le légionnaire Hans, à la taille d’un Hercule et au courage d’un félin. Il narguait tout le monde au bar, comme dans la rue, percutait celui-là, molestait un
autre. Les gens le craignaient et l’évitaient. Même la police militaire ne l’inquiétait pas. Il était parvenu ainsi à être honni par les Arabes et les Français. Un soir de bringue, en rentrant à la caserne, il fut tué dans un bosquet de tamarix de l’oued.
Au bout de quelques jours, la gendarmerie fut dans l’impossibilité quête ne bloqua à identifier le coupable et ficela le dossier en accusant X. Mais le crime n’était pas crapuleux et les jours passants, il eut une certaine connotation nationaliste, car le nationalisme était en effervescence à Ain-Sefra, comme partout en Algérie. Le coupable anonyme fut tôt encensé par les Musulmans. Tout le monde en parlait, c’était le point du jour de tous les jours. Un matin, Mohamed se rend chez le chef de la commune mixte et lui déclare : « Hé ! Hé ! Hé ! C’est moi qui l’ai tué ». Il est embarqué, transféré au tribunal militaire d’Oran. Il écopa de cinq ans de prison et fut ramené par train jusqu’à Méchéria. De là, il fut transféré à la prison de Tabelbala, conduit par des cavaliers spahis. Il était vraiment glorieux de son exploit et les prisonniers l’admiraient, l’adulaient. Il purgea une année, quand le directeur de prison le convoqua et lui déclara placidement : « Mohamed, ce n’est pas toi le tueur. Tu es libre, rentre chez toi ».
Voilà comment cet ouvrage rend hommage à des gens ordinaires qui avaient créé leurs propres légendes. C’est ce que vous découvrirez en le lisant et plusieurs fois en interpellant votre esprit critique comme le suggère l’internaute dans sa note de lecture.
Ajouter un commentaire